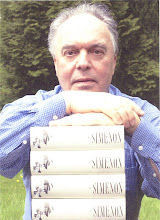Compte rendu de l’ouvrage d’Alexandre DessinguÉ, Le Polyphonisme du roman. Lecture bakhtinienne de Simenon, Bruxelles, pie Peter Lang, « Documents pour l’Histoires des Francophonies », n° 26, 2012, 247 p., 39,10 €
 L’ouvrage
d’Alexandre Dessingué présente un double intérêt : d’une part, il propose
au lecteur de s’initier à la pensée complexe de Mikhaïl Bakhtine (1895-1975),
célèbre (et controversé) théoricien de la littérature, et, d’autre part, il
interroge la vie et l’œuvre de Georges Simenon sous différents aspects. En
effet, les théories de Bakhtine sont caractérisées par leur caractère global,
qui permet à Alexandre Dessingué d’envisager l’œuvre de Georges Simenon à la
fois du point de vue de l’auteur, du texte et du lecteur.
L’ouvrage
d’Alexandre Dessingué présente un double intérêt : d’une part, il propose
au lecteur de s’initier à la pensée complexe de Mikhaïl Bakhtine (1895-1975),
célèbre (et controversé) théoricien de la littérature, et, d’autre part, il
interroge la vie et l’œuvre de Georges Simenon sous différents aspects. En
effet, les théories de Bakhtine sont caractérisées par leur caractère global,
qui permet à Alexandre Dessingué d’envisager l’œuvre de Georges Simenon à la
fois du point de vue de l’auteur, du texte et du lecteur.
Je
ne chercherais pas à résumer ici la présentation théorique qui occupe le début
de l’ouvrage. Retenons seulement la notion principale de la pensée de Bakhtine,
le fameux « dialogisme » entendu comme « un réseau interactif de
voix et de consciences plus ou moins indépendantes » : en bref, cette
notion s’est traduite, dans le chef de Bakhtine, par une opposition entre
Tolstoï, auteur dont la voix unique domine tout le texte, et Dostoïevski, qui
s’efface derrière les voix plurielles et contradictoires de ses personnages. Simenon
est à ranger à cet égard du côté de Dostoïevski, comme nous le démontre
Alexandre Dessingué.
En
dehors de l’exercice intellectuel qu’il accomplit avec brio, intéressant en
soi, l’ouvrage de Dessingué présente-t-il un intérêt particulier pour les
études simenoniennes, se demandera-t-on. Sans aucun doute. Mais il m’a semblé
que certaines parties étaient plus novatrices que d’autres. Ainsi, les
chapitres biographiques, réservés à la « polyphonie auctoriale »,
c’est-à-dire aux divisions de la personne de Simenon, brassent un savoir biographique
existant, comme l’auteur le souligne lui-même : « l’objectif de cette
première partie du travail qui plonge dans l’univers social et psychologique de
l’auteur n’était pas tant de révéler des éléments nouveaux de la vie de
l’auteur qui est aujourd’hui bien connue, mais de cerner comment se manifeste
la polyphonie au niveau du sujet créateur […] » (p. 105-106). Cela ne
l’empêche toutefois pas de prendre des positions personnelles, par exemple au
sujet de la mère de l’écrivain : « Il faut peut-être considérer
l’attitude d’Henriette Brüll comme la conséquence du fait qu’elle aime
maladroitement et non pas, comme on le dit souvent de manière peu convaincante,
parce qu’elle préfère le frère Christian de trois ans plus jeune. »
(p. 68)
La
partie centrale, consacrée à la « polyphonie structurelle »,
c’est-à-dire au texte narratif, m’a paru beaucoup plus neuve. C’est surtout là
qu’Alexandre Dessingué s’attache à la question du dialogisme particulier à
l’œuvre chez Simenon. Ce dernier ne s’y efface pas tout à fait :
« […] le dessein artistique de l’auteur ne réside pas dans l’affirmation
d’une vérité détenue par une conscience “archi-textuelle”, mais par la quête de
cette même vérité à laquelle la conscience auctoriale prend part. […] si la grande question posée par l’auteur est bien
celle du “qui est l’homme ?”, la réponse ne consiste pas chez lui à une
affirmation émanant d’une conviction personnelle mais à la représentation d’une
multitude de personnages en tant que conscience de leur propre réalité (“le qui
suis-je ?”). » (p. 154) Dans cette partie de l’ouvrage, Alexandre
Dessingué, qui fait partout preuve d’une bonne connaissance de la littérature
secondaire consacrée à son auteur, dialogue volontiers avec ses pairs,
notamment avec Jacques Dubois au sujet du « réalisme minimaliste »
(p. 136) de Simenon et avec Bernard Alavoine à propos de son
« impressionnisme » (p. 145).
Enfin,
la troisième partie, consacrée à la polyphonie réceptive, c’est-à-dire à la
place du lecteur, est tout à fait originale, le lecteur ayant été peu envisagé,
me semble-t-il, dans le cadre des études simenoniennes (si ce n’est, mais d’un
point de vue plus sociologique, récemment par Véronique Rorhbach). Alexandre
Dessingué montre ici que tous les romans ne confèrent pas le même rôle au
lecteur. Selon les différentes formules du roman simenonien, ce dernier est
amené à succomber à l’illusion réaliste, à s’identifier, à éprouver de la
sympathie ou de l’empathie ou à prendre une distance critique.
Ainsi,
Alexandre Dessingué souligne-t-il de manière nouvelle la richesse de l’œuvre de
Georges Simenon.
Laurent Demoulin